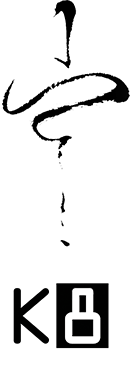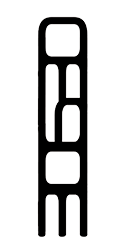Pascal Picard
Natif du Bas du Fleuve, mais résident au Saguenay depuis près de vingt ans, Pascal Picard a complété un baccalauréat à l’UQAM en 1997 dans le domaine des communications graphique. C’est après un tour du monde de trois ans et demi, où il a pratiqué de façon autodidacte le dessin, la peinture et la photographie, qu’il entreprend un baccalauréat et termine par la suite une maîtrise en arts interdisciplinaire à l’UQAC en 2014.
Il expose professionnellement depuis 2012 dans les différents centres d’artistes tel que BANG, ESPACEPOINTCA, Langage Plus et le Centre National d’Exposition au Saguenay / Lac-St-Jean. Il a exposé également au Centre de diffusion Presse Papier de Trois-Rivières et à Caraquet à la galerie d’art contemporain Bernard-Jean par le biais du centre d’artistes Constellation bleue. Il exposera, en septembre 2026, au Centre d’exposition à Amos.
Il reçoit en 2012 et 2013 la bourse des professeurs de maîtrise de l’UQAC. En 2014, il obtient la bourse du CAS, CAM, CALQ de l’atelier Saguenay / Montréal pour une résidence au centre d’artiste OBORO à Montréal. Il obtient en 2016 une autre bourse du CAS et un atelier afin de préparer son exposition : DIAGNOSTICS. Finalement en août 2024, il entreprend une résidence de deux semaines au Village Historique Acadien. Une initiative du Centre d’artistes la Constellation bleue.
Dans les dernières années, il a la chance de faire partie des collections privées de l’École le Passage (2015), de l’Université du Québec à Chicoutimi (2009-14), de la Société et d’histoire de Beauport (2009), de la ville de Saguenay (2019) et du cégep de St-Félicien (2024).
C’est en 2017 qu’il inaugure à Jonquière le K8 qui est, encore aujourd’hui, son atelier de travail, de recherches et d’expérimentations. L’endroit se base sur le principe de facteur infini de création, sans se restreindre à des critères de création précis. L’objectif de l’atelier est d’utiliser la rencontre pour donner un élan aux idées et de permettre leurs réalisations dans un contexte d’échanges et de partages.
.
DÉMARCHE 2000-25
Mes recherches consistent, par les arts numériques, le dessin, la sérigraphie et la peinture, à m’emparer de l’état actuel du concept de «portrait peint» pour le retourner en dynamique (et problématique) de création. Portraitiste, je réfléchis les notions de soustraction, de transition et de formes.
La soustraction est un concept abstrait qui attira mon attention en 2009. L’eau, translucide, me permet de nettoyer, de changer et de rompre la matière peinture. Elle casse et détruit les pigments qui se superposent dans des ordres définis. Je m’aperçus qu’enlever la matière dépasse la simple technique et prend tout son sens dans le processus de création. Ce concept consiste donc, en totalité ou en partie, à associer tout propos philosophique, méthodologique et technique à la perte, le manque, le -1, la différence. La sérigraphie, la gravure sur verre et l’imprimerie m’ont permis d’établir mes premiers barèmes de recherche pour encadrer de manière méthodique mes expérimentations visuelles en peinture et en dessin.
En 2013, j’ai réalisé l’exposition Transition. Dans ce corpus d’œuvres, j’ai représenté l’homme en le mettant face à certaines limites figuratives. Les forces du temps, du mouvement et de la matière sont différentes dynamiques qui m’aident à confronter la structure du portrait dans son environnement. Affaiblir ou accumuler la matière devient une ouverture dialectique en ce sens où, derrière le trait qui s’efface, qui s’épuise, apparaissent des énergies qui ne demandent qu’à réfléchir.
C’est en 2016, au centre Bang de Chicoutimi, que je présentai Diagnostic. Cette exposition sur la synthèse soustractive permettait au public de comprendre le processus de transformation des pigments de peinture et ses différents comportements par la superposition et la soustraction (au pinceau) des filtres de couleurs synthétiques primaires C, M, Y et K (cyan, magenta, jaune et noir). Le but était d’imiter, en des temps beaucoup plus lents, des résultats probables d’après le processus mécanique de l’imprimerie quadrichromique traditionnelle.
Chaque toile possède également un code QR qui, une fois scanné avec un téléphone intelligent, permet de voir le procédé d’intervention dans le virtuel. Par ce code, je propose de réduire davantage l’identité du sujet cobaye, qui n’est déjà plus qu’une fade copie de son original, en un simple code bidimensionnel renvoyant sur une plate-forme virtuelle plus vivante.
L’année suivante, en 2017, Langage Plus accueilli les œuvres Zone Grise Part 1 et 2, lors de l’exposition collective Espaces Pigmentés. Avec ce projet, j’ai voulu dépasser l’œuvre peinte en la soustrayant elle aussi à travers d’autres médiums. Par la peinture, la photo, la vidéo, la projection et le web, j’ai exploré les notions de disparition, d’altération et d’effacement dans le mouvement, le temps, l’espace et la forme. La projection vidéo permet de laisser le processus de déconstruction en vie, comme une Zone Grise, qui s’étend au-delà de la matière. Le virtuel devient ce prolongement, cette chute dans le vide numérique dans lequel l’image se poursuit.
Dans la continuité de mes recherches sur la synthèse soustractive, j’introduis dans les corpus Écho et Équilibre, créés respectivement entre 2019 et 2021, la sérigraphie. Elle me permet de me distancer, de me soustraire, de devenir témoin, d’une certaine manière, du processus de création des territoires nouvellement mis en place dans mes recherches visuelles.
En 2024 avec Cohésion (CNE), je questionne certains enjeux de la réalité virtuelle, augmentée et mixte au sein de notre société actuelle. Ce projet me permet d’entamer de nouvelles réflexions avec le public au sujet de mon travail artistique et sur les futures utilisations sociales et environnementales de ces technologies et de leurs impacts dans le quotidien de chacun.
Incarnation présenté à Trois-Rivières en mai 2025, est un projet d’exposition qui propose une exploration poétique des réalités hybrides, où le Moi et l’autre Moi coexistent. L’œuvre aborde l’errance psychologique d’un sujet en quête d’identité, confronté à un manque de soutien réel. Dans une société marquée par la prolifération d’avatars virtuels, ces doubles numériques deviennent des espaces d’expression et de confiance, permettant de surmonter les inhibitions sociales.
En septembre, de la même année, j’ai présenté à Caraquet, au Nouveau-Brunswick, l’exposition D’un imprimeur à l’autre qui marque la conclusion d’un projet de recherche-création initié lors d’une résidence artistique immersive de deux semaines au Village historique acadien, intitulée « Une île-village, une traversée dans le temps » (2024).
Le but de ce projet était de mettre en évidence les liens profonds qui unissent l’artiste à l’artisan, depuis la fonction jusqu’au savoir-faire, en analysant les contradictions et les complémentarités entre l’art actuel et les techniques artisanales traditionnelles.
(À VENIR) Prochaines recherches: Rédemption, 2026
PP